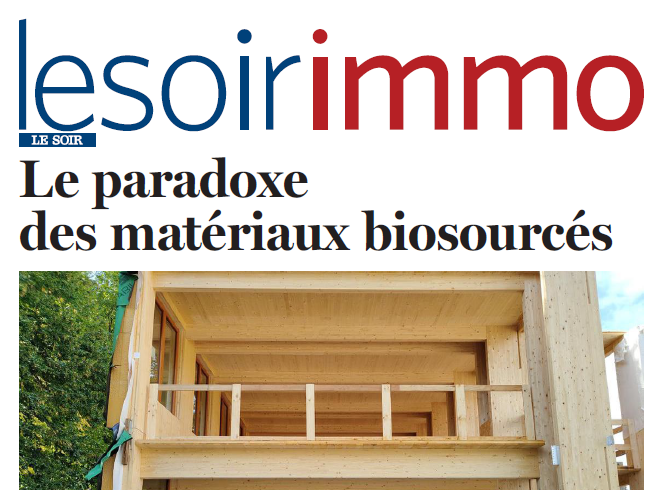
Atouts environnementaux, qualités techniques... le recours aux matériaux biosourcés apparaît comme l’une des pistes les plus prometteuses pour réduire l’impact carbone des bâtiments. Et pourtant, ils tardent à être adoptés. Voici les raisons qui expliquent ce paradoxe.
Article issu du journal Le Soir Immo du 18/09/2025.
Auteur : Jean-François Munster, Bernard Padoan et Frédéric Delepierre
Le dossier - Pourquoi les matériaux biosourcés peinent à convaincre
Le marché des écomatériaux reste petit malgré leurs bienfaits pour l’environnement et leurs qualités techniques. De nombreuses raisons peuvent l’expliquer.
 Béton, brique, acier, polyuréthane, laine de verre… c’est le cocktail de matériaux qui règne en maître dans le secteur de la construction depuis des décennies. Pour combien de temps encore ? La prise de conscience de leur impact environnemental, que ce soit en termes d’extraction des ressources naturelles, d’émissions de CO 2 , de production de déchets, se fait de plus en plus grande et amène à repenser la manière de construire. A côté de la réutilisation, le recours aux matériaux biosourcés apparaît comme l’une des pistes les plus prometteuses pour réduire l’impact carbone des bâtiments. On parle ici des matériaux issus de la biomasse (structures en bois, isolants en paille, fibres de bois, herbe, chanvre, lin, liège, laine de mouton…), des matériaux minéraux peu transformés (argile, terre crue…) et de ceux issus du recyclage (ouate de cellulose, carton, textile, verre).
Béton, brique, acier, polyuréthane, laine de verre… c’est le cocktail de matériaux qui règne en maître dans le secteur de la construction depuis des décennies. Pour combien de temps encore ? La prise de conscience de leur impact environnemental, que ce soit en termes d’extraction des ressources naturelles, d’émissions de CO 2 , de production de déchets, se fait de plus en plus grande et amène à repenser la manière de construire. A côté de la réutilisation, le recours aux matériaux biosourcés apparaît comme l’une des pistes les plus prometteuses pour réduire l’impact carbone des bâtiments. On parle ici des matériaux issus de la biomasse (structures en bois, isolants en paille, fibres de bois, herbe, chanvre, lin, liège, laine de mouton…), des matériaux minéraux peu transformés (argile, terre crue…) et de ceux issus du recyclage (ouate de cellulose, carton, textile, verre).
Pourtant, même si ces matériaux présentent d’indéniables atouts environnementaux (faible empreinte carbone, stockage de CO 2 , facilité de déconstruction, absence de polluants…) et techniques (meilleure isolation contre le chaud, bonne régulation de l’humidité de l’air, bienfaits en termes de qualité de l’air, d’acoustique…), ils tardent à être adoptés. Comment l’expliquer ?
 Pour Anne-Michèle Janssen, directrice du cluster wallon Eco-construction, le problème ne vient certainement pas de l’offre. Que du contraire. « En Wallonie, le secteur est très dynamique et innovant avec pas moins de 20 producteurs d’écomatériaux », insiste-t-elle. « Il est en mesure de répondre à 65 % des besoins en isolation prévus en vue d’atteindre les performances fixées pour 2050 (neutralité carbone, NDLR) mais, malheureusement, ces usines travaillent à 30-40 % de leur capacité et bon nombre d’entre elles vendent plus à l’étranger qu’en Belgique. »
Pour Anne-Michèle Janssen, directrice du cluster wallon Eco-construction, le problème ne vient certainement pas de l’offre. Que du contraire. « En Wallonie, le secteur est très dynamique et innovant avec pas moins de 20 producteurs d’écomatériaux », insiste-t-elle. « Il est en mesure de répondre à 65 % des besoins en isolation prévus en vue d’atteindre les performances fixées pour 2050 (neutralité carbone, NDLR) mais, malheureusement, ces usines travaillent à 30-40 % de leur capacité et bon nombre d’entre elles vendent plus à l’étranger qu’en Belgique. »
Agréments coûteux
Elle pointe une faiblesse de la demande, liée à des réglementations freinant l’accès au marché. « On demande à des matériaux qui ont quelques années d’existence d’afficher les mêmes garanties de qualité que des matériaux qui sont là depuis des décennies. Il faut obtenir des agréments techniques pour chaque matériau. Tous ces tests coûtent cher alors qu’on est souvent face à des entreprises de petite taille qui n’ont pas les budgets. » Elle prend l’exemple des tests de résistance aux incendies. « Il faut tester toutes les différentes façons dont le produit sera mis en oeuvre. Or, en construction bois, il y a une multitude de combinaisons possibles. Si on veut tout tester, on en a pour dix ans. Les laboratoires ne sont pas équipés et les tests trop onéreux. »
Le biosourcé souffre aussi d’un problème d’image. Même si les esprits évoluent, les stéréotypes – « des matériaux pour bobos écolos » – ont la vie dure. Il y a surtout un problème de méconnaissance. « Aujourd’hui, on sait pratiquement tout faire en biosourcé mais les professionnels du bâtiment ignorent toutes les possibilités qui existent », explique Emmanuel Malfeyt, coordinateur du cluster bruxellois de l’écoconstruction, ecobuild.brussels.
A tel point que des acteurs sont apparus ces dernières années pour « éduquer » le marché. C’est le cas de la firme Natura Mater, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des architectes en matière de biosourcé. « Les architectes ont un grand pouvoir de prescription », souligne Margaux Cambier, co-fondatrice. « Le problème, c’est qu’ils ne connaissent pas toujours bien ces matériaux. Ils n’ont pas le temps de se renseigner. Nous avons développé une expertise que l’on partage avec eux. On les aide à sélectionner les bons matériaux, on leur fournit les données techniques, les endroits où on peut se les procurer. Bref, on leur facilite la vie. »
Peur du changement
 Les promoteurs du biosourcé doivent à chaque fois se battre contre la force des habitudes et la peur du changement. « Les marges sont tellement faibles dans le secteur de la construction que les entrepreneurs – qui doivent offrir une garantie de dix ans à leurs clients – ne veulent prendre aucun risque financier et préfèrent continuer à utiliser ce qu’ils connaissent », déplore Anne-Michèle Janssen.
Les promoteurs du biosourcé doivent à chaque fois se battre contre la force des habitudes et la peur du changement. « Les marges sont tellement faibles dans le secteur de la construction que les entrepreneurs – qui doivent offrir une garantie de dix ans à leurs clients – ne veulent prendre aucun risque financier et préfèrent continuer à utiliser ce qu’ils connaissent », déplore Anne-Michèle Janssen.
Ce problème de manque de confiance tend néanmoins à s’estomper. Les matériaux biosourcés ont eu le temps de faire leurs preuves depuis leur introduction sur le marché il y a parfois plus de 20 ans. Ils disposent aussi de plus en plus souvent des agréments techniques et des labels prisés par le secteur de la construction. « Ces quatre dernières années, Buildwise (ex-Centre scientifique et technique de la construction) a publié beaucoup de référentiels de construction (infos techniques, normes validées par le secteur) qui ont permis de rassurer les entrepreneurs sur les performances techniques de ces matériaux et sur leur longévité… », explique Benoît Michaux, responsable de la recherche sur les matériaux. « Les recherches ont permis de définir précisément le périmètre d’utilisation de ces matériaux. Les entrepreneurs savent mieux comment et où les placer. Aujourd’hui, on voit de grosses sociétés de construction les utiliser de façon fréquente. »
L’expert de Buildwise pointe cependant « des problèmes de disponibilité des matériaux et de stabilité des prix ». « Le secteur n’a pas encore atteint le même niveau d’industrialisation que celui des matériaux pétrosourcés ou minéraux. Un grand groupe de maisons clé sur porte ne veut pas avoir à se fournir auprès de quatre fabricants différents pour un isolant car il cherche à s’appuyer sur sa puissance d’achat pour bénéficier des prix plus intéressants. Il veut aussi être certain que l’isolant qu’il a vendu à ses clients sera bien celui qu’il placera au final. » A ce niveau-là aussi, Benoît Michaux constate des progrès. « Le secteur s’industrialise de plus en plus. » En outre, de grands groupes de matériaux de construction « traditionnels » comme Soprema, Knauff ou Derbigum se mettent eux aussi à proposer des matériaux biosourcés ou issus du recyclage.
Le prix, le nerf de la guerre
Ce processus d’industrialisation devrait permettre de faire baisser les prix et rendre les écomatériaux plus compétitifs face à leurs équivalents pétrosourcés ou minéraux. Car le prix reste bien sûr le nerf de la guerre. « J’ai travaillé sur un projet de crèche où il était prévu de placer des isolants en laine de bois et des panneaux de liège », témoigne un architecte. « Quand le client a vu la hauteur du devis, la première chose qu’il a faite a été de sacrifier le biosourcé. La laine minérale était deux fois moins chère. »
Cette différence de prix reste difficilement objectivable. Pour certains matériaux, elle existe. Pour d’autres pas. « Il est toujours possible de remplacer un matériau conventionnel par un matériau biosourcé au même prix et avec les mêmes exigences techniques », affirme Emmanuel Malfeyt. « Mais il faut bien connaître le marché et mener des recherches approfondies, ce que les gens n’ont pas toujours le temps de faire. » « Il faut se méfier des comparaisons faciles », ajoute de son côté Margaux Cambier. « Oui, le polyuréthane est moins cher mais c’est du plastique et de l’air. Ça n’isole absolument pas contre la chaleur estivale et ça pollue énormément. En revanche, un isolant biosourcé permettra de protéger le bâtiment contre les fortes chaleurs et de réaliser des économies en n’installant pas d’air conditionné. L’un dans l’autre, qu’est-ce qui est le plus cher ? »
« L’énergie grise des matériaux a été négligée »
Tous les acteurs s’accordent sur le fait que le marché des biosourcés a besoin de réglementations environnementales qui prennent mieux en compte l’impact CO 2 des matériaux pour pouvoir se développer. « A Bruxelles, on a adopté dès 2015 les normes de haute performance énergétique pour le bâti neuf et les rénovations en profondeur », explique Emmanuel Malfeyt, coordinateur d’ecobuild.brussels. « A l’époque, on s’est focalisé sur la baisse des émissions de CO 2 durant toute la durée de vie du bâtiment (PEB), considérant que l’énergie grise nécessaire pour produire les matériaux était négligeable. Avec cette législation, on a certes réussi à diminuer les émissions de CO 2 des bâtiments mais on a dans le même temps augmenté la part d’énergie grise (le polyuréthane ou la laine de verre sont très énergivores). On se rend compte aujourd’hui qu’on a trop négligé cette dimension. »
On voit aujourd’hui apparaître des législations prenant mieux celle-ci en compte. En France, par exemple. Sa réglementation environnementale ne se concentre plus uniquement sur la performance énergétique des bâtiments mais sur les émissions carbone au sens large. Elle fixe des seuils à ne pas dépasser en matière d’émissions de gaz à effet de serre liées « aux produits et équipements de construction, et à leur mise en oeuvre lors du chantier ».
« Ce changement a largement bénéficié à l’industrie des biosourcés », explique Anne-Michèle Janssen, du cluster wallon Eco-construction. « On voit aujourd’hui des géants du secteur de la construction comme Bouygues ou Eiffage construire des bâtiments en bois et en paille, ce qui était impensable il y a encore quelques années. » Elle s’attend maintenant à ce que la Wallonie suive cette voie. « La Région est en train de revoir sa réglementation PEB pour tenir compte des obligations européennes en matière de bilan carbone et d’analyse de cycle de vie. »
Pour Emmanuel Malfeyt, il y a toute une panoplie de mesures que le monde politique pourrait prendre pour encourager l’utilisation de matériaux biosourcés : obligation d’en intégrer un certain pourcentage par bâtiment, taxe CO 2 pour désavantager les matériaux polluants, budget CO 2 à respecter par bâtiment… « Peu importe comment on y arrive mais il faut favoriser le biosourcé et le réemploi si on veut continuer à faire diminuer l’empreinte CO 2 des bâtiments. » J.-F.M.
Architecture Une lente (r)évolution
 Architecte installé à Ciney, travaillant au sein du bureau A-lien, Hervé Barbeaux s’est spécialisé dans l’écobioconstruction. Des techniques qui étaient peu enseignées lors de ses études à Saint-Luc (Liège), comme l’utilisation de la terre crue, et qu’il a découvertes à l’occasion de stages sur chantiers. Il les met aujourd’hui en oeuvre dans son quotidien d’architecte.
Architecte installé à Ciney, travaillant au sein du bureau A-lien, Hervé Barbeaux s’est spécialisé dans l’écobioconstruction. Des techniques qui étaient peu enseignées lors de ses études à Saint-Luc (Liège), comme l’utilisation de la terre crue, et qu’il a découvertes à l’occasion de stages sur chantiers. Il les met aujourd’hui en oeuvre dans son quotidien d’architecte.
Comment évolue la demande pour l’utilisation de matériaux biosourcés dans les projets de construction ou de rénovation ?
On voit une croissance lente, même si ça reste le fait de gens qui sont conscientisés. Ce sont aussi fréquemment des clients qui sont prêts à mettre la main à l’ouvrage, pour lesquels cela apparaît plus facile à faire qu’avec des matériaux conventionnels. Il y a un côté économique : le gros oeuvre peut être réalisé par un entrepreneur et ils peuvent terminer la construction eux-mêmes. Des visites de projets dans le cadre de portes ouvertes sont aussi une bonne manière de sensibiliser les gens. Ils ressentent tout de suite le confort à l’intérieur d’une maison où on a utilisé par exemple des enduits comme l’argile ou la chaux, ou des plaques de gypse naturel plutôt que le conventionnel gyproc. Les matériaux biosourcés sont aussi une réponse à ceux qui cherchent un environnement intérieur à vivre plus sain. De manière générale, le ressenti en termes de confort acoustique, d’hygrométrie, de chaleur ou de ventilation est immédiat.
Ce sont les principaux avantages de ces matériaux ?
 Un des grands défis aujourd’hui est d’éviter la surchauffe. Une isolation avec un matériau pétrosourcé comme le polyuréthane ou la laine de verre, ça fonctionne bien pour garder la chaleur en hiver. Mais il y a un effet « boîte thermos » en été : la chaleur traverse très vite ces isolants légers, et elle ne ressort plus. Avec des matériaux comme la cellulose, la fibre de bois ou des fibres végétales comme la paille, le chanvre ou l’herbe, ce que l’on appelle le « déphasage thermique » (la vitesse de passage de la chaleur à travers un matériau isolant, NDLR) est nettement meilleur. Ils permettent aussi une meilleure « perspirance » des parois : on travaille les murs un peu comme une peau humaine, qui est imperméable à l’extérieur, mais qui laisse s’échapper l’humidité de l’intérieur. Quand c’est posé dans le bon ordre de juxtaposition des matériaux, cela limite fortement les besoins de ventilation artificielle. On travaille aussi sur l’inertie, avec l’argile ou les blocs silico-calcaires, qui apportent de la masse à l’intérieur de la construction pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Un des grands défis aujourd’hui est d’éviter la surchauffe. Une isolation avec un matériau pétrosourcé comme le polyuréthane ou la laine de verre, ça fonctionne bien pour garder la chaleur en hiver. Mais il y a un effet « boîte thermos » en été : la chaleur traverse très vite ces isolants légers, et elle ne ressort plus. Avec des matériaux comme la cellulose, la fibre de bois ou des fibres végétales comme la paille, le chanvre ou l’herbe, ce que l’on appelle le « déphasage thermique » (la vitesse de passage de la chaleur à travers un matériau isolant, NDLR) est nettement meilleur. Ils permettent aussi une meilleure « perspirance » des parois : on travaille les murs un peu comme une peau humaine, qui est imperméable à l’extérieur, mais qui laisse s’échapper l’humidité de l’intérieur. Quand c’est posé dans le bon ordre de juxtaposition des matériaux, cela limite fortement les besoins de ventilation artificielle. On travaille aussi sur l’inertie, avec l’argile ou les blocs silico-calcaires, qui apportent de la masse à l’intérieur de la construction pour garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Mais il y a des inconvénients…
Tout n’est évidemment pas magique et il faut bien maîtriser la mise en oeuvre. Ces matériaux biosourcés peuvent être plus sensibles à l’eau et ne doivent par exemple pas être utilisés pour des murs enterrés. Le coût est aussi malheureusement supérieur, parce que la demande est encore trop faible et que ces matériaux utilisent des ressources locales plus chères que ce que produit la pétrochimie à grande échelle.
A combien peut-on évaluer ce surcoût ?
C’est difficile à dire, dans la mesure où cela dépend des projets. Il faut comparer ce qui est comparable : il y a un investissement un peu plus important au départ, mais qui peut être récupéré ultérieurement dans les besoins de chauffage, de ventilation et de climatisation qui sont moindres. Disons que quand je commence un avant-projet d’écobioconstruction, je démarre sur une base d’environ 2.000 euros/m 2 HTVA. L’important c’est de bien comprendre chaque système constructif pour en tirer les avantages respectifs. Et de concevoir des projets assez simples pour que la technique soit mise en oeuvre facilement et éviter de faire grimper les prix.
La disponibilité de ces matériaux biosourcés est-elle suffisante ?
Oui, ils sont largement disponibles. A dire vrai, les producteurs que nous avons en Wallonie disent tous qu’ils ont les capacités pour en produire davantage. Mais le développement économique reste limité, on l’a vu. L’image des « trois petits cochons » reste très forte. Beaucoup de gens ont toujours l’impression que construire en bois ou en paille, c’est moins solide qu’en briques. C’est aussi lié à ce qu’on voit dans l’offre des promoteurs, qui reste fortement basée sur ce modèle. Pourtant, le bois ou la paille, c’est très durable et très résistant s’ils sont correctement mis en oeuvre. Mais je vois que les choses bougent, que certains promoteurs s’intéressent aussi à la bioconstruction, c’est une façon pour eux de proposer des produits différents. Le marché se développe, mais il se développe lentement. Ça bouge beaucoup plus en France par exemple, où des grands groupes comme Bouygues font des grands projets immobiliers en construction bois ou en construction paille.
Le dossier - Woolconcept aimerait imposer l’isolation à base de laine de mouton
La jeune entreprise des Hautes Fagnes collecte la laine chez les éleveurs wallons et la transforme en panneaux isolants pour toitures et cloisons. Ils donnent droit à des primes et une surprime de la Région wallonne.
A la tête d’une entreprise spécialisée dans les toitures depuis 1985, Paul Zanzen s’est mis en tête, dès le début des années 2000, de trouver des alternatives aux isolants traditionnels. C’est en Allemagne qu’il trouve son bonheur. Dans une foire, il découvre un isolant fabriqué avec de la laine de mouton sous forme de panneaux pour toitures, de feutres et en vrac. En 2006, il devient importateur exclusif pour le Benelux et commence à les proposer à ses clients.
« Au début, le marché n’était absolument pas prêt à recevoir ce genre de produits », se souvient Jérémy Zanzen, fils de Paul, cofondateur et responsable du marketing au sein de Woolconcept. « Mais mon père tenait à proposer un produit écoresponsable et sain pour les clients et pour le personnel qui le place car mon frère avait été gravement malade en plaçant de la laine de roche quelques mois plus tôt. La laine de mouton, elle, peut se poser à main nue et sans masque. De plus, elle rappelle le passé lainier de notre région proche de Verviers. »
« Le point de bascule est survenu en 2014 lorsque nous nous sommes aperçus qu’à Verviers, Traitex, le dernier lavoir de laine d’Europe occidentale, prend en charge la laine de France, d’Autriche, d’Allemagne et d’ailleurs », poursuit Jérémy Zanzen. « Cette laine est ensuite réexpédiée dans son pays d’origine, ce qui représente une empreinte carbone considérable. Nous avons alors décidé de ne plus importer d’isolants mais de les confectionner nous-mêmes avec de la laine belge. » En 2022, Paul Zanzen part à la retraite et confie les rênes de l’entreprise à ses deux fils, Jérémy et William. Le premier prend en charge le marketing et le développement des produits et le second crée une filière de tonte et de collecte de laine de mouton active à travers toute la Wallonie.
Convaincre les éleveurs
 « Il n’est pas toujours facile de convaincre les éleveurs de nous vendre leur laine », regrette Jérémy Zanzen. « Ça leur prend du temps de tondre, de rassembler et de trier la laine qu’il faut ensuite amener à un point de collecte. C’est pourquoi, depuis des dizaines d’années, ils n’en font rien. Certains l’enfouissent même dans le sol. Nous, en fonction de la qualité du produit, nous leur payons entre 30 centimes et 1,30 euro le kilo. Celle dans laquelle on retrouve encore un peu de paille ou de foin est la moins chère et peut être utilisée pour la fabrication de l’isolant. Celle de meilleure qualité va notamment servir pour la fabrication de couettes. »
« Il n’est pas toujours facile de convaincre les éleveurs de nous vendre leur laine », regrette Jérémy Zanzen. « Ça leur prend du temps de tondre, de rassembler et de trier la laine qu’il faut ensuite amener à un point de collecte. C’est pourquoi, depuis des dizaines d’années, ils n’en font rien. Certains l’enfouissent même dans le sol. Nous, en fonction de la qualité du produit, nous leur payons entre 30 centimes et 1,30 euro le kilo. Celle dans laquelle on retrouve encore un peu de paille ou de foin est la moins chère et peut être utilisée pour la fabrication de l’isolant. Celle de meilleure qualité va notamment servir pour la fabrication de couettes. »
Les panneaux isolants fabriqués par Woolconcept peuvent avoir une épaisseur de quatre, de six, de huit ou de dix et douze centimètres. « Pour les confectionner, il faut d’abord ouvrir la laine », détaille le responsable marketing. « On la mélange ensuite avec une fibre bi-composants, qui est une forme de polyester qui représente 15 % des panneaux. C’est ce qui permet d’obtenir un isolant qui est semi-rigide. Une fois que les fibres sont ouvertes et bien mélangées, on les souffle vers la cardeuse dont les petites aiguilles orientent les fibres dans le même sens. On obtient alors une fine pellicule de laine. Superposées, ces pellicules vont permettre d’atteindre l’épaisseur désirée pour avoir la densité de 25 kilos par mètre cube, par exemple. Pour terminer, l’ensemble passe au four, ce qui fait durcir la fibre bi-composants et donne un panneau isolant. »
Qui dit matériau biosourcé, dit souvent coût plus élevé. Les panneaux de Woolconcept ne dérogent pas à la règle. « Pour l’isolant, il faut compter deux euros/mètre carré par centimètre d’épaisseur, soit 20 euros/mètre carré pour du dix centimètres », précise Jérémy Zanzen. « Nous sommes donc deux ou trois fois plus cher que les isolants conventionnels. Par rapport à de la laine de bois, autre isolant biosourcé, nous sommes 20 % plus cher. Mais la durée de vie de la laine est beaucoup plus longue. Sur le long terme, nous sommes plus intéressants. »
Verviers, de nouveau cité lainière
Pas de quoi freiner le consommateur, cependant. « Jeunes ou moins jeunes, ceux qui ont des convictions environnementales viennent nous voir », sourit le jeune entrepreneur. « Tous les ans, notre chiffre d’affaires monte de 10 %. Ce qui motive peut-être les clients, ce sont les primes à l’isolation octroyées par la Région wallonne. Certes, elles ont diminué par rapport à celles qui prévalaient sous le précédent gouvernement mais il en reste. Pour l’obtenir, il faut une isolation de 20 centimètres dans la toiture et de 18 centimètres dans les cloisons. Il existe même une surprime pour l’isolation biosourcée. Comme nos panneaux sont labellisés, le client peut en bénéficier. »
Même si les affaires de son entreprise sont florissantes, Jérémy Zanzen aimerait que les pouvoirs publics incitent davantage les citoyens à investir dans les matériaux biosourcés. « Les primes, c’est bien mais il faudrait aussi, comme le fait la France, pénaliser les personnes qui utilisent des matériaux énergivores, no cifs pour l’environnement et pour la santé », suggère l’entrepreneur qui trouve aussi que les pouvoirs publics devraient donner l’exemple en utilisant des isolants biosourcés lors de la construction ou de la rénovation des écoles, maisons de repos ou bâtiments administratifs.
Ecologiques, les panneaux à base de laine de mouton sont performants, recyclables et ils filtrent l’air. Ils ne sont pour autant pas exempts de critiques car certains accusent la laine d’être gourmande en eau pour être nettoyée. « Bien sûr, nous avons besoin d’eau mais pour réduire sa consommation, Traitex a installé une station d’épuration », rétorque Jérémy Zanzen. « Les eaux usées sont filtrées et réinjectées dans le circuit jusqu’à ce qu’elles soient impropres à l’utilisation. Ce n’est qu’alors qu’elles sont envoyées dans les égouts. L’entreprise a également installé des panneaux solaires récemment. »
L’avenir, le duo de frangins qui dirige Woolconcept le voit radieux. « D’ici trois ans, nous ambitionnons de doubler la quantité de laine transformée pour, à terme, prendre en charge toute la laine wallonne », lance Jérémy. « En outre, actuellement, la fabrication des panneaux et du feutre est confiée à une entreprise de Courtrai. Dans notre logique de réduire les distances, pourquoi ne pas construire notre propre ligne de production à Verviers pour en refaire une cité lainière ? Même si c’est un gros investissement… »
Télécharger l'article original
